Les propriétaires d’embarcations légères et nautiques (canot, kayak, chaloupe, planche à pagaie) ont accès gratuitement à une station de lavage au parc Missisquoi-Nord à Eastman (37 rue des Pins Sud). La construction de cette station de lavage est le fruit d’une collaboration entre les municipalités de Bolton-Est et Eastman afin d’intensifier leurs efforts pour combattre les espèces exotiques envahissantes (EEE).
Station de lavage pour petites embarcations
Parc Missisquoi-Nord
37, rue des Pins Sud
Eastman (Québec) J0E 1P0
Tarif : Gratuit
*Notez que la station de lavage sert exclusivement à nettoyer les embarcations nautiques. Une surveillance caméra est en fonction et les fautifs sont passibles d’amendes.
Station de lavage pour grandes embarcations
Parc Normand
59, chemin des Normand
Eastman (Québec) J0E 1P0
Tarif : 5 $ pour les embarcations non-motorisées et de 15 $ pour les embarcations motorisées
Les deux stations de lavage sont accessibles en tout temps de la mi-avril à la mi-octobre.
Un geste nécessaire et obligatoire
Il est essentiel de nettoyer les embarcations avant de changer de plan d’eau pour limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes. La Municipalité d’Eastman a un règlement qui oblige le lavage des embarcations avant toute mise à l’eau. Le présent règlement s’applique à tous les plans d’eau situés en tout ou en partie sur le territoire de la municipalité d’Eastman.
Des horodateurs émettent une preuve de lavage une fois l’embarcation nettoyée, ce qui évite des amendes aux utilisateurs en cas de contrôle de la part de la patrouille verte, qui sera active durant toute la belle saison.






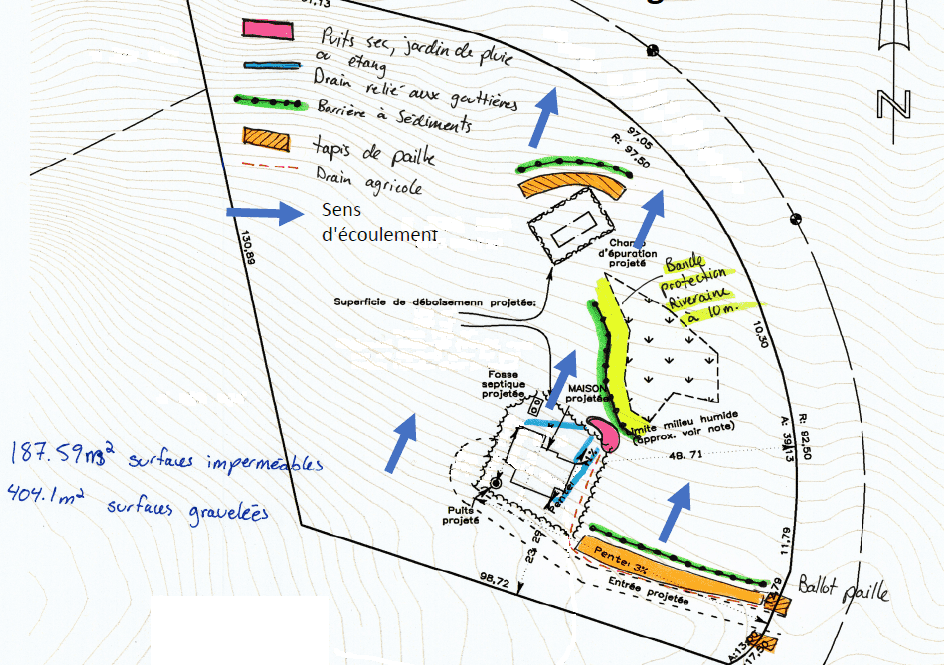



 Bonnes pratiques environnementales pour les citoyens
Bonnes pratiques environnementales pour les citoyens